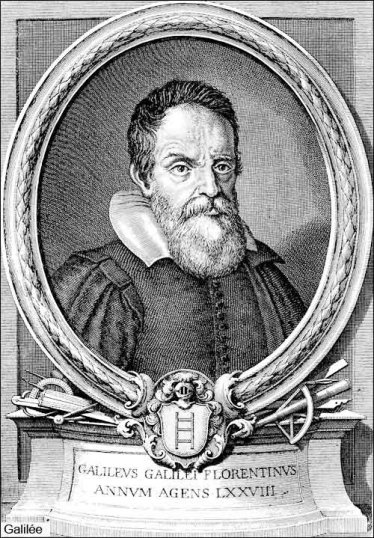Le coq a chanté plus d’une fois trois fois
I. anthropocentrisme, humanisme, laïcité, trahison
Passablement long, ce titre, n’est-ce pas, amis lecteurs ; beaucoup trop long en tout cas pour que j’y ajoute encore le sous-titre que voilà : « ... comment les “conservateurs” savent conserver ce qui les arrange et déformer, oublier ou trahir ce qui les dérange ». Mais commençons par le commencement et plongeons un instant dans le fleuve de l’histoire.
Dans la vision du monde des penseurs de l’antiquité, l’anthropocentrisme fut loin d’être une « philosophie » dominante. Ostracisés par les dirigeants et fréquemment accusés d’impiété, ses défenseurs adoptèrent souvent un profil bas ou se turent. L’anthropocentrisme ne disparut toutefois jamais. Défendu timidement par les épicuriens puis par les stoïques, il connut un moment de gloire sous L’empereur Marc-Aurèle (121–180) pour replonger ensuite sous la tyrannie des empereurs-dieux, puis sous l’hystérie religieuse de fin d’empire et enfin sous la chape de plomb du christianisme triomphant. Il devra attendre le soir du Moyen-âge pour faire son retour, et encore... Mais constituera-t-il réellement un progrès par rapport au théocentrisme (tout théorique d’ailleurs) de Platon, d’Aristote et des grandes religions monothéistes ? (1) On pourrait le croire : l’homme devenant peu à peu conscient de sa valeur, donc le centre de ses préoccupations, sans qu’il cesse pourtant de croire à quelque principe divin, créateur ou bienveillant, quoi de plus rassurant ?
En Europe, entre le 13ème et le 14ème siècle, l’anthropocentrisme recommença à poindre et à affronter, d’abord de manière voilée, le théocentrisme chrétien, grâce à des philosophes théologiens comme Guillaume d’Ockham, mais surtout à travers l’oeuvre de nombreux poètes. Je pense aux Walther von der Vogelweide, Guillaume de Loris, Rutebeuf, Pétrarque, Boccace, Dante, ou Christine de Pisan, pour ne citer que ceux-là. Suivit la Renaissance, qui en fut le premier corollaire avec les Rabelais, Montaigne, Ronsard, Politien, Pic de la Mirandole, Nicolaus von Cues, Pierre de La Ramée, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno, Reuchlin, Cisneros, Erasmus, Thomas Moore et tant d’autres. Les arts, les lettres, les sciences commencèrent timidement à s’affranchir de la pensée théocratique. Tout en n’osant pas encore la contester frontalement, l’homme faisait son retour.
Le barrage craquait par tous les bouts et, malgré l’inquisition, ce fut, deux à trois siècles durant, un feu d’artifice de nouvelles formes d’expression, de contestations, d’explorations, de découvertes. Suivit l’imprimerie et les Jean Hus, Luther, la Réforme, Copernic et son « nouveau » cosmos, Descartes, Galilée, l’accès à l’Extrême Orient et aux Amériques ouvrirent la pensée et les perspectives de l’homme, pour le livrer, désormais privé de l’imaginaire parachute divin, aux démons de la fortune et de son choix. Le docteur Faust avait voulu être (2), eh bien, il était. Nouveau Prométhée, démiurge autoproclamé, à lui de se débrouiller !
En fait, globalement, les chrétiens commençaient à se lasser des dictats de l’Église et ne demandaient pas mieux. Autoproclamé nombril de l’univers, l’homme commença à s’émanciper. Spinoza, Galilée, Descartes, Leibniz, Kant, les Lumières, la Révolution française, Hegel et Karl Marx lui feront prendre conscience de sa valeur et reconnaître les valeurs essentielles à sa dignité. En Occident, le principe humaniste s’affirme qui, au-delà des terribles travers que seront l’impérialisme colonial, le racisme, la Shoa, les deux guerres mondiales et la troisième qui perdure sans dire son nom, cet humanisme donc, voudrait s’ériger en valeur refuge de la civilisation occidentale.
Conversion réussie ? Peut-on donc considérer l’anthropocentrisme comme un progrès par rapport au théocentrisme ? À première vue, oui. Mais, à y regarder de plus près, n’en serait-il pas plutôt le dévoiement, un sous-produit à contrario, une perversion en quelque sorte ? L’homme s’étant proclamé démiurge, ne remplace pas dieu pour autant, mais le renvoie à une lointaine création et le cantonne au boulot d’assureur-réassureur, système bonus/malus compris (3), bien sûr. Comme quoi Allianz, Axa et consorts n’ont rien inventé. Du théocentrisme et de l’anthropocentrisme issus de la réduction des vieilles religions anthropomorphes, c’est, à mon avis, le premier qui est fantaisiste (mais humain) et le second dérisoire. Le fait que ce dernier considère que dieu existe, mais ne joue désormais plus qu’un rôle accessoire, ne compense en rien la minusculité et l’impuissance relative de l’homme.
Si, me considérant moi-même humaniste, je crois que le véritable humanisme serait un grand pas en avant, tout comme d’ailleurs l’écologie qui n’en est qu’une des conséquences logiques (4), et s’il était ce qu’il devrait être : davantage un mode d’emploi qu’un dogme bafoué. J’aimerais donc plutôt le considérer comme un authentique modus vivendi, une feuille de route et une boussole à la fois, permettant aux pauvres microbes que nous sommes de traverser l’océan de la vie et de construire notre civilisation le mieux que nous pouvons.
On est aujourd’hui, hélas, loin du compte. Force est de constater que, outre d’essayer de rendre à l’homme l’importance qui lui revient – en soi une bonne chose – l’humanisme contemporain n’a pas su se débarrasser des tares de l’anthropocentrisme : individualisme féroce (le « et moi, et moi, moi » - stigmatisé par Lanzmann et Dutronc) et libéralisme conquérant (d’Adam Smith à Milton Friedman & Co) qui en dérivent. Aujourd’hui, ces caractères prenant de plus en plus d’importance, ils se voient contestés en Occident, voire complètement de plus en plus rejetés au Sud par les masses laborieuses et défavorisées. Incapables de voir au-delà des recettes connues et encouragées en cela par des bergers obtus ou/et intéressés, elles tendent à condamner l’humanisme en bloc et à revenir au théocentrisme.
Il est vrai qu’à bien des égards l’humanisme contemporain, essentiellement « occidental » ne mérite pas mieux que d’être désavoué. Coincé grosso modo dans l’occident atlantiste, respecté par les puissants à la manière du « Prince » de Machiavel, seulement dans la mesure où ça les arrange, l’humanisme s’est vu couper les ailes avant même d’avoir eu l’occasion de s’épanouir. Né donc de l’anthropocentrisme, de la Renaissance, des Lumières et de la Révolution française, mais embarqué successivement sur les vaisseaux conquérants du capitalisme rapace, du colonialisme, du néocolonialisme et du néolibéralisme, il n’est plus qu’une fausse-couche de ce qu’il eût pu être. Quoi d’étonnant dès lors, que le pire arrive et que les masses (re)jettent, par un retour en force de la religion sous sa forme la plus puérile, revancharde et conquérante, ce foetus en même temps que les eaux polluées. Dès lors, ce n’est plus seulement un humanisme avorté qui passe peu à peu à la trappe, mais également la laïcité qui n’a vu le jour que dans de rares pays, où elle tente de défendre son existence bec et ongles. (5)
à suivre
***
1) le théocentrisme (grec théo = dieu) place dieu (et ses représentants) au centre du monde et des soucis humains, lorsque l’anthropocentrisme (grec anthrôpos = être humain) place l’être humain au centre du monde. Ne pas confondre avec « anthropomorphisme » qui revêt dieu ou les dieux de caractères humains. Dans la religion « du charbonnier » et l’imagerie populaire théocentrisme et anthropomorphisme vont souvent de pair.
2) selon Leo Ruickbie - Faustus : The Life and Times of a Renaissance Magician (The History Press, 2009) – le mythe de Faust pourrait remonter à la fin du Moyen-Âge polonais. Pour les nombreuses exploitations littéraires et artistiques du mythe de Faust, dont la plus célèbre reste celle de Goethe, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Faust.
3) peu efficace, car malgré les bonus paradisiaques et les malus infernaux, le nombre de salopards n’a jamais été, toute proportion gardée, moindre chez les croyants que chez les athées, bien au contraire.
4) rappelons que l’écologie n’est pas l’amour et le respect de la nature en soi. C’est simplement la science de l’habitat (le meilleur et le plus harmonieux possible pour l’être humain et pour tout ce qui vit sur terre, qui constitue justement notre unique habitat).
5) Sur la séparation laïque de l’Etat et des Eglises lire aussi l’article sur http://renaissance.communiste.over-blog.com/article-22791376.html, traitant du problème en France, mais de manière assez proche des préoccupations de n’importe quel citoyen européen.
Giulio-Enrico Pisani